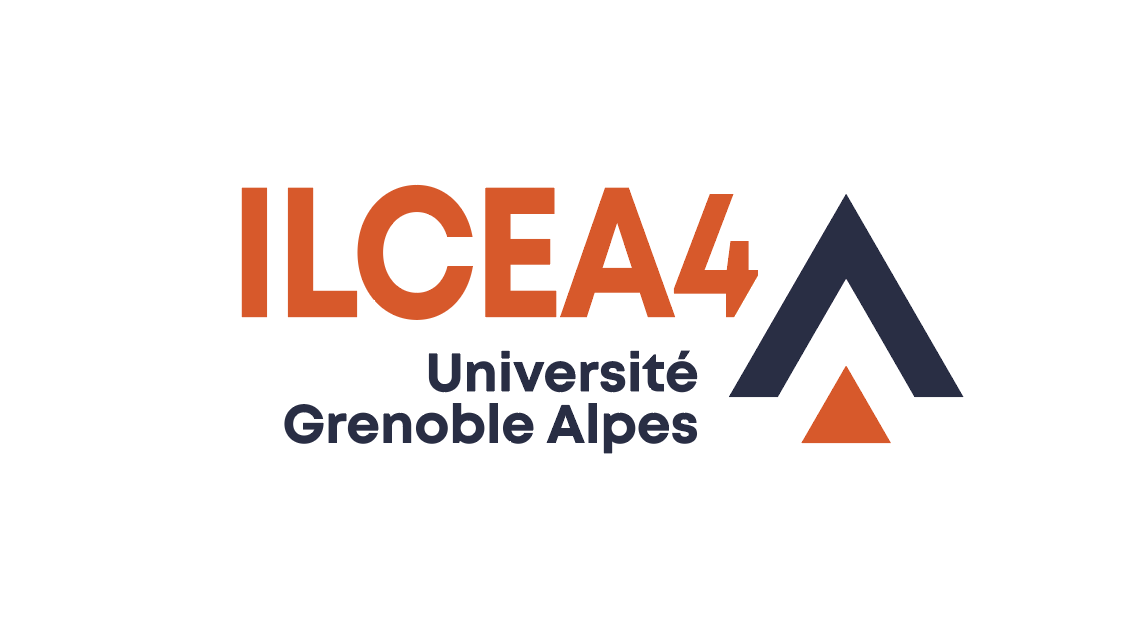After noting the absence of a French-language History of Russian literature depicting postmodernism as a phenomenon of the Yeltsin years, we ponder the existence of a Russian postmodernist literature and the need to find a place for it. Methodological difficulties arise from the definition of the term itself, the specificity of Russian postmodernism in relation to the Western model, and the question of continuity or rupture between modernism and postmodernism. Comparing the works of Mark Lipovetsky, Mikhail Epstein, Vyacheslav Kuritsyn, Irina Skoropanova, and Olga Bogdanova, this article shows that each of these writers proposes his own periodization. Some (Lipovetsky, Epstein) consider postmodernism to be a phenomenon related to the Yeltsin years, while others give it a much broader temporal scope, associating it with everything that followed the Thaw of the 1960s (Skoropanova, Bogdanova). There are also quite large differences between the corpora these writers propose. The particular case of the poet Iossif Brodsky is indicative of a certain tendency to label any work that deviates from the traditional canon as postmodernist. This article suggests that it is best to limit the period to the 1990s, which is the period of the controversy surrounding the concept of “postmodernism,” and to establish the corpus by using both the criterion of the author’s intention and reception theory (Jauss).
Après avoir fait le constat de l’absence en français d’une « Histoire de la littérature russe » faisant mention du postmodernisme, en tant que phénomène des années El′cin, on s’interroge sur l’existence d’une littérature postmoderniste russe et sur la nécessité d’en déterminer la place. Les difficultés méthodologiques sont liées à la définition du terme et à la spécificité russe par rapport au modèle occidental, en particulier à la question de la continuité ou de la rupture entre modernisme et postmodernisme. L’article compare les thèses de Mark Lipoveckij, Mixail Epštejn, Vjačeslav Kuricyn, Irina Skoropanova, Ol′ga Bogdanova, et constate que la périodisation varie selon les points de vue des historiens. Les uns (Lipoveckij, Epštejn) considèrent le postmodernisme comme un phénomène lié aux années El′cin, tandis que d’autres lui accordent un champ temporel beaucoup plus étendu, englobant toute la période qui a suivi le Dégel des années 1960 (Skoropanova, Bogdanova). La délimitation du corpus ne fait pas non plus consensus. Le cas particulier du poète Iosif Brodskij est révélateur d’une certaine tendance à qualifier de postmoderniste toute œuvre qui s’écarte du canon traditionnel. L’article suggère de s’en tenir à une temporalité étroite, celle des années 90, bornée par la polémique des revues littéraires sur le terme « postmodernisme », et de recourir, pour la délimitation du corpus, au critère de l’intention de l’auteur et à la notion d’esthétique de la réception (Jauss). justifiée dont jouit cette Histoire de la littérature russe, à laquelle ont participé les plus éminents spécialistes russes et étrangers, et qui demeure un outil inégalé pour l'enseignant ou l'étudiant, il peut sembler nécessaire et légitime, près de trente ans plus tard, de proposer un regard plus éclairé sur ce « troisième » dégel, ainsi que sur les années qui ont suivi la perestroïka. Il est temps d'envisager d'écrire le chapitre suivant. Pour cela, il faudra considérer au préalable certaines questions méthodologiques qui restent encore non résolues.
Selon Igor Zolotousski, auteur du chapitre « La littérature du troisième dégel », la littérature russe de la fin des années 1980 aspirait à un retour à la normalité, elle cherchait à retrouver le monde des valeurs fondées sur la morale chrétienne (ETKIND et alia, p. 904). Aujourd'hui, nous connaissons mieux l'importance des nombreux mouvements anticonformistes, tels que le conceptualisme moscovite ou les poètes du groupe de Lyanozovo, qui ont préparé le postmodernisme des années 90. Or dans le chapitre cité, le mot « postmodernisme » n'est utilisé qu'une seule fois. En outre, il est employé avec un accent peu équivoque, révélant un jugement explicitement dépréciatif : L'usage des termes « négativement », « répéter », « caricaturer », ainsi que l'emploi du « on » (« on refuse », « on écrit ») sont manifestement péjoratifs. Les universitaires dénient toute originalité et sincérité aux nouveaux écrivains. Les auteurs notent bien que « l'ironie est l'arme de presque toute la nouvelle vague littéraire », mais l'importance de cette littérature est minorée, et son existence est presque niée : « Et pourtant le courant social et critique l'emporte sur cette prose et cette poésie. Que ce soient les récits sur l'armée du vétéran de la guerre afghane Oleg Ermakov[…], ou encore ceux de l'appelé Alexandre Terekhov,